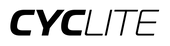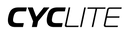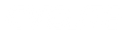ENTRETIEN AVEC UN CYCLISTE – CHRISTOPH STRASSER

Christoph Strasser est l’un des ultra-cyclistes les plus titrés au monde. Il a participé neuf fois au Race Across America et l’a remporté à six reprises. Mais pour lui, il ne s’agit plus seulement de watts ou de temps intermédiaires. Dans cette interview, Christoph parle de ses débuts, de l’équilibre entre aventure et compétition, de son approche pragmatique de l’équipement, de ses stratégies mentales dans les moments de doute – et de ce qui rend le Transcontinental Race si fascinant pour lui aujourd’hui.
Si un inconnu te demandait de te décrire en une phrase, que dirais-tu ?
Je m'appelle Christoph et, depuis 20 ans, j’ai fait de mon hobby – parcourir à vélo la plus grande distance possible, le plus rapidement possible – mon métier.
D’où vient ton surnom « Straps » ?
Bonne question. Ça vient en quelque sorte de mon nom de famille, Strasser – une forme abrégée. Ça n’a rien à voir avec les sous-vêtements érotiques, même si c’est marrant, car le bronzage cycliste, qui passe du foncé au clair au niveau des cuisses, y ressemble un peu. Mais en réalité, c’est un surnom qui me suit depuis l’école, et il est resté. Je le trouve plutôt amusant – on peut tout à fait m’appeler comme ça officiellement.
Comment as-tu découvert l’ultra-cyclisme ?
Ma première rencontre avec ce monde n'était pas vraiment un hasard, mais elle n'était pas prévue non plus. Nous voulions former une équipe de quatre pour une course de 24 heures, mais deux d'entre nous ont annulé à la dernière minute. On s’est dit : dommage de perdre les 35 euros d'inscription, alors on va tenter le coup chacun en solo. À l'époque, je ne m'entraînais pas du tout – je faisais deux sorties de deux heures par semaine, juste pour le plaisir. Forcément, ma performance a été très mauvaise, mais j’ai vu des gens rouler 24 heures sans s’arrêter, et j’ai trouvé ça incroyablement fascinant. Juste de voir de quoi les êtres humains sont capables.
En même temps, le Race Across America était très populaire en Autriche et souvent présent dans les médias – reportages télé, livres, articles. Le rêve de participer au RAAM a commencé à germer dans un coin de ma tête.
C’était en 2002. Je dirais qu’à partir de 2006, j’ai commencé à m’entraîner sérieusement – environ 25 à 30 heures par semaine. Chaque année, je participais à des courses de plus en plus longues. C’est drôle, parce qu’aujourd’hui la boucle est bouclée. À mes débuts, je rêvais plutôt d’un tour du monde à vélo ou du chemin de Compostelle à vélo. Mais ensuite, les courses sont venues s’intercaler. J’ai été complètement captivé, aussi mentalement. Et maintenant, des années plus tard, l’aspect aventure revient en force.
Pendant le Race Across America, je ne me souciais même plus du fait de traverser les États-Unis. Je voulais juste aller vite, ne pas perdre de temps et améliorer ma performance. C’était une vraie course cycliste. Et aujourd’hui, dans les courses sans assistance, l’aspect aventure est redevenu central.

Qu’est-ce qui te fascine dans l’ultra-cyclisme ?
Ce qui me fascine, c’est la combinaison entre la compétition et l’aventure. Une aventure pure – comme les voyages à vélo tranquilles dans de beaux pays – ce n’est pas ce qui m’attire pour le moment. Peut-être un jour. En ce moment, j’ai encore cette envie de compétition et cette forte motivation. Les courses d’ultra-cyclisme sont donc la combinaison parfaite pour moi.
Tu as participé à de nombreuses courses, comme le Race Across America, plusieurs fois. Qu’est-ce qui te pousse à y retourner encore et encore ?
Je pense que j’éprouve une vraie joie à pousser les choses à l’extrême. Lors de mon premier RAAM, la grande question était : Est-ce que je peux réussir ? Est-ce seulement possible ? Je n’y suis pas parvenu la première fois. Alors c’était évident pour moi : je dois revenir et réussir cette fois. Et à ma deuxième tentative, j’ai gagné. J’ai compris à ce moment-là qu’il y avait encore beaucoup de potentiel. Il y avait encore plein de choses que je pouvais améliorer.
J’aime profondément explorer un sujet – pas forcément un nouveau pays ou une nouvelle course – mais vraiment m’immerger dans quelque chose, l’étudier à fond. C’est ça que je trouve passionnant. Et aussi comparer : OK, l’année dernière ça s’est passé comme ça, cette année autrement – comment puis-je faire mieux l’année prochaine ? C’est aussi ce qui me fascine avec la Transcontinental. Le défi est toujours nouveau, car le parcours change chaque année. Au RAAM, le parcours était toujours le même.
Et je ne me dis pas : « OK, je l’ai fait, c’est bon, je coche la case ». On peut dire que je suis tombé amoureux du RAAM.
Et aussi de la Transcontinental Race. C’est un peu une relation amour-haine. Les sections off-road ne sont pas mon truc, mais elles font partie du jeu. Et dans l’ensemble, l’expérience me plaît tellement que j’ai envie de recommencer.
Je ne ressens pas vraiment le besoin d’essayer quelque chose de nouveau chaque année. Je préfère rester fidèle à ce que je connais et créer une vraie connexion avec ça.
Comment récupères-tu après de si longues courses ?
Dormir, manger, s’amuser, profiter. Juste célébrer un peu l’expérience. Je m’entraîne toujours beaucoup et de manière intense, et cela implique aussi, durant l’année, de faire attention à son alimentation et de mener une vie saine. Mais après une course, il faut savoir lâcher prise et se faire plaisir : manger, boire, faire la fête.
Je pense que la récupération est surtout mentale. Il s’agit de penser à autre chose après s’être concentré intensément pendant plusieurs mois sur un objectif.
Comment gères-tu ton alimentation pendant ces longues courses ?
Autrefois, au RAAM, j’avais un plan nutritionnel très précis. On avait des protocoles, et je savais exactement : une bouteille de boisson énergétique par heure, plus une bouteille d’électrolytes. Mais ça ne fonctionne que si tu peux emporter une quantité illimitée de ravitaillement – donc avec un véhicule d’assistance.
Dans les courses sans assistance, ma plus grande peur a toujours été d’avoir la diarrhée ou des nausées. Que mon système digestif ne tienne pas le coup, que je m’alimente très mal, et que ça nuise à ma performance. Mais étonnamment, le corps peut fonctionner assez longtemps avec de la nourriture de station-service.
Pour moi, les règles de base sont : rien qui puisse périmer. Je ne prendrais rien du rayon frais – pas de légumes ou de salade d’œufs, car ça pourrait être avarié.
Ce doivent être des choses faciles à digérer, et de préférence des aliments que je connais déjà. Pas forcément une spécialité turque que je n’ai jamais goûtée de ma vie – mieux vaut du pain blanc nature et un sirop sucré à diluer avec de l’eau. Des barres de chocolat, des baguettes emballées sous vide. Des choses dont on sait : ce n’est pas réfrigéré, c’est hermétique, donc pas de bactéries à l’intérieur.
Quand on entend les histoires du Silk Road Mountain Race, où 50 % des participants ont des intoxications alimentaires, c’est vraiment fou. Là-bas, il n’y a quasiment pas d’alternative. Mais s’il y a une option, je choisis toujours des aliments non périssables. Qui peuvent rester trois semaines en plein soleil et rester comestibles.
J’emporte aussi une petite quantité de poudre pour boisson, avec des électrolytes et tout ça. Je prépare mes mélanges en route, mais on ne peut emporter que de petites quantités.
En général, je suis quelqu’un de très prudent. Je veux zéro risque – que ce soit pour les pièces de rechange ou la nourriture. C’est pourquoi j’emporte toujours un peu plus. Je veux être convaincu, au départ, que rien ne pourra complètement me désarçonner. Je suis prêt à tout scénario.
Ça veut dire avoir un peu plus de bagages. Mais ça libère l’esprit. Malheureusement, ça veut aussi dire aller un peu moins vite en montée, car tu portes quelques kilos en plus. Ça coûte un peu de vitesse, mais je l’accepte volontiers.

Écoutes-tu des podcasts ou de la musique quand tu roules ?
À l’entraînement, j’écoute énormément de podcasts. En course, absolument pas – je trouve ça trop ennuyeux dans ce Kontext, ça me rend plutôt somnolent. En course, j’ai une playlist et je reviens toujours à mes morceaux préférés. Dans les courses ultra, on passe aussi beaucoup de temps à rouler de nuit.
T’entraînes-tu à gérer le manque de sommeil ?
Non. J’ai fait le calcul une fois : si tu additionnes tous les jours de course, j’ai passé environ un demi-année à faire des courses à vélo. Prends 8 jours de RAAM, couru 9 fois – ça fait déjà 72 jours et 72 nuits. Ajoute à ça plein d’autres courses, des épreuves de 24 heures et le TCR trois fois. Au total, j’ai roulé l’équivalent d’un demi-année à travers la nuit. Je crois que je n’ai plus besoin de “m’entraîner” spécifiquement pour ça. Quand tu l’as vécu souvent, tu sais comment gérer. Et physiquement, on ne peut pas vraiment s’entraîner efficacement au privation de sommeil ou à la fatigue.
Es-tu encore nerveux avant les courses ?
Oui, bien sûr. Mais beaucoup plus avant la Transcontinental. Presque pas avant le RAAM. Au RAAM, tu peux vraiment éliminer tous les facteurs de risque : tu as l’équipe d’assistance, les bagages, les pièces de rechange – tout est là. Il ne reste qu’une question : peux-tu délivrer ta performance ? Et là, j’ai toujours eu confiance.
À la Transcontinental, c’est l’inconnu total. Que se passe-t-il si tu n’as pas de chance ? Si tu as une panne ? Si tu as oublié quelque chose ? Tu n’es jamais totalement en sécurité, et ça crée pas mal de tension. Je suis quelqu’un de très calme, difficile à déstabiliser, mais oui, je suis quand même très excité avant le départ. Je ne sais jamais ce qui va arriver pendant la course.
Tu roules surtout sur route. Comme la Transcontinental comporte aussi des portions off-road, pourrais-tu imaginer participer à une course 100 % off-road comme l’Atlas Mountain Race ?
Honnêtement, non. Je suis un grand fan des courses sur route parce que, pour moi, courir à vélo signifie aller vite. Dans les ultra-courses VTT, il s’agit surtout de vaincre le terrain, porter le vélo sur les pierres, pousser… et tu avances lentement. Tu es exposé aux éléments.
Pour moi, une course à vélo, c’est aller vite. Aussi vite que possible. Et ce n’est pas du tout le cas en VTT. Je n’ai jamais vraiment attrapé le virus du tout-terrain. J’ai pourtant commencé par le VTT, les premières années. Mais dès que j’ai eu mon premier vélo de route, j’en suis tombé amoureux – et je n’ai plus jamais regardé mon VTT.
Quand tu tombes dans un creux mental pendant une longue course, as-tu des stratégies pour en sortir ?
Ça dépend de la cause : une mauvaise phase physique, une erreur de navigation, la fatigue pure, ou un problème technique sur le vélo.
Ce qui marche toujours, la base, c’est de ne pas espérer que tout se passera parfaitement. Ça n’arrivera jamais. Dès le départ, je m’attends à des moments de désespoir, à des passages où je me sentirai mal. Donc quand ça arrive, je ne suis ni surpris ni déstabilisé.
Si tu souhaites que tout roule, tu seras déçu dès que ça se complique. Moi, je sais d’avance : des problèmes vont arriver à 100 %. Donc je ne suis pas déçu quand ils surgissent. C’est normal. Et du coup je peux rester assez détendu. S’énerver ne sert à rien, être de mauvaise humeur ne sert à rien, abandonner encore moins.
Si tu es planté au milieu de nulle part, que tu te sens mal et que tu arrêtes, tu es toujours au milieu de nulle part… et tu te sens toujours mal. La seule façon d’aller mieux, c’est de continuer à rouler et, idéalement, d’atteindre l’arrivée pour t’allonger dans un lit. Là, ce sera mieux. Abandonner en route n’améliore rien.
Après chaque creux, il y a un moment où ça repart. Toujours. Parfois il faut juste être patient et attendre.
As-tu un équilibre à côté du vélo dans ta vie quotidienne ? Un sport alternatif ?
Pas vraiment. Je ne fais pratiquement pas de sport alternatif – je suis trop fatigué par l’entraînement. En été, j’aime bien faire un peu de kayak. Tranquille, quelques heures sur l’eau à flâner. Pas d’aventures ambitieuses. Pas de programme croisé structuré. Beaucoup de vélo… et sinon, se détendre.
As-tu un plat favori avant une course ?
J’essaie toujours de cuisiner moi-même et surtout de ne pas aller au restaurant. Je ne veux pas risquer de manger quelque chose de douteux avant une course. Je préfère acheter des pâtes et de la sauce tomate – simple, mais bien toléré. Et surtout, je peux gérer la quantité. Aller au resto, c’est la catastrophe : tu commandes un bon plat et tu repars encore faim. Toujours frustrant. Quand tu cuisines toi-même, tu peux manger à ta faim – c’est bien plus satisfaisant pour un cycliste.
Y a-t-il quelque chose que tu emportes toujours en ultra – un petit secret ou un objet inattendu ?
Je connais un athlète qui a gagné le TCR trois fois et qui était célèbre pour toujours emporter un rasoir. Il se rasait avant de remonter sur le vélo, même après une heure de sommeil. D’autres prennent un peigne, par exemple. Moi, rien de tout ça – je suis assez pragmatique.
Mon petit tic, c’est que je prends tout en double. Passeport, carte d’assurance, un deuxième téléphone. J’ai toujours peur de perdre quelque chose. Et je ne prends pas seulement 20 euros – j’en prends 20 deux fois. Une fois sur moi, une fois dans la sacoche.

Si tu pouvais remonter le temps, que dirais-tu à ton moi d’avant ta première course d’ultra ?
Curieusement, je ne dirais pas que j’ai fait quoi que ce soit de mal ou que j’étais complètement à côté de la plaque à l’époque. Je me dirais simplement : fais-le comme tu le sens, de la manière qui te semble juste.
À quoi ressemblerait une journée parfaite dans ta vie ?
Faire la grasse matinée, puis bien sûr une belle sortie à vélo. Et le soir, faire un petit barbecue et s’allonger sur une couverture de camping au bord d’un lac pour regarder le coucher du soleil. Et rester éveillé très tard.
J’adore être actif la nuit. Si je le peux, je me lève à neuf heures et je vais me coucher à deux heures du matin. C’est mon rythme préféré. Malheureusement, ça ne marche pas souvent, car la vie impose quelques rendez-vous ici et là. Disons que je ne suis pas du matin.
Y a-t-il une course ou une région que tu n’as pas encore explorée et où tu aimerais rouler un jour ?
Oui, bien sûr. Le NorthCape 4000 me semble magnifique, même si ce n’est pas une vraie course. Mais cette région tout au nord me fait rêver. Les pays scandinaves seraient un pur bonheur à parcourir à vélo. Il y a aussi le NorthCape–Gibraltar, qui a lieu tous les deux ans. C’est une épreuve à laquelle je pense parfois participer. Mais c’est assez petit, il y a très peu de participants. Ce que j’aime aussi dans la Transcontinental, c’est qu’il y a 350 participants – c’est plus vivant. Une course avec seulement 20 personnes, c’est moins excitant.
Traverser le Canada me semble aussi incroyablement attirant. Mais là-bas, il n’y a presque rien, juste du terrain sauvage. Je suis plus attiré par les pays du Nord, parce que je trouve que le froid est cent fois plus agréable que la chaleur.
Images : © Lex Karelly Photography